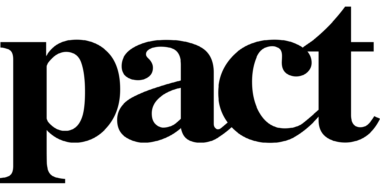Benjamin Sabatier
WIP
March 1 - April 12, 2025
Ways of Doing – Text for the exhibition Work in Progress
« In the technocratically built, written, and functionalized space where they circulate, the trajectories of consumers form unpredictable sentences, ‘traverses’ that are partially illegible (…), tracing the ruses of other interests and desires that are neither determined nor captured by the systems in which they develop. »
Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, 1990
In Old French, the expression bayer aux corneilles referred to someone’s tendency to marvel at insignificant objects. The « rooks » of the past described everyday things rather than the birds we associate with the term today. Like Hanta, the press worker in Bohumil Hrabal’s novel who dreamt at night of stacking into infinite piles the books his factory job forced him to destroy during the day¹, Benjamin Sabatier’s sculptures stem from the wandering of the workshop, the small rebellion of the master builder, and that deeply human need to balance whatever is within reach when the hands of the clock take too long to turn. No plan, no strategy, no project management—just an intuition, a « what if », sparked by the chance encounter of a support beam, a scrap of wood, an artwork remnant, a can of strong beer, or a bag of cement left there under the Diogenic principle of « you never know, it might come in handy ».
Piled onto a platform, Work in Progress presents a collection of 25 sculptures created by Benjamin Sabatier between 2004 and 2024. Twenty years of labor—where the term takes on a particular significance—best understood through Claude Lévi-Strauss’s distinction between the engineer and the bricoleur². Whereas the engineer approaches the world theoretically and abstractly, with access to a virtually unlimited array of resources always absent from his office, the bricoleur works in the workshop, in the immediate and constant proximity of a limited stock of materials, tools, and pre-existing objects that may not be the best suited for the job but with which he has developed a familiarity. Hours spent daydreaming in the silent company of objects, listening to what their internal mechanics and associative logic suggest, give rise to a poïétique, a continuous dialogue where Benjamin Sabatier negotiates with the materials the idea of a form they create together. What is at stake here is the physical being of matter and its countless possible transformations. Twisted, bent, sanded, planed, crumpled; rearranged according to the principles their uses inspire—wood, concrete, cement, steel, and the sum of materials excluded from classical art discourse—assert their qualities, laws, resistance, stubbornness, and insistence on simply being there, refusing to vanish behind the final illusion of a closed and completed artwork. The relationship between Benjamin Sabatier and concrete, bricks, and clamps is one of camaraderie. It is through mutiny against the conventional expectations of form in art that these sculptures emerge – playful, nonchalant, and forthright.
Seeking points of tension, rupture, or balance – pushing just to the limit before the structure collapses: if these experiments lie at the heart of Benjamin Sabatier’s sculptural practice, they also underpin his entire body of work. Whether sharpening pencils for 35 hours, 7 hours a day, 5 days a week, without ever drawing³, stacking rolls of tape reminiscent of monuments to the Third International, or delegating the assembly of his works to collectors—complete with assembly guides, sketches, and instructions—Benjamin Sabatier has spent nearly his entire career not doing, not acting. Or rather, doing as little as possible while still meeting the requirements that the enterprise of art demands of its workers. In this sense, his true feat does not lie in a constant defiance of physics but in having made bricolage the principle through which he exists both as an artist and in the world. Bricolage is an attitude, and this attitude becomes these forms that function but always seem as though they were never fully realized. The materials stand by, either bewildered or amused, watching the one meant to transform them gaze at rooks, fantasizing about the possible encounter between reinforced concrete and a wooden wedge—and the forms emerge from this attitude, revealing that the everyday is improvised and that its potential resides in the immediate environment.
When bricolage adapts reality to make it livable, it becomes poaching. This thesis is developed by Michel de Certeau, who, in the 1970s, rejected the idea that individuals are merely passive, standardized, and dispossessed beings, free only within the liberties allowed by their environments⁴. Against this supposed inactivity, Certeau opposed the creative function of poaching—not the grand construction of a masterwork but a series of reappropriations, small ruses, and daily practices he called « ways of operating ». And that is precisely what Benjamin Sabatier accomplishes when he sees marble in a bag of cement or a chisel in a support beam. On land he inhabits but does not own, the artist weaves his way through the mesh of a system, collecting what is useful and, in the same gesture, shaping both an artwork and an ethic. Assembling, making, unmaking; negotiating, sanding, twisting, tightening: to the amniotic paralysis in which the present moment stagnates, Benjamin Sabatier opposes action verbs—a collection of sculptures to be practiced, reread, recopied, as a series of tricks, tutorials, and hacks shared peer-to-peer. Like the Whole Earth Catalog⁵—a small practical guide to do-it-yourself that he cherishes—Work in Progress can be read as a manual, whose first chapter states that the everyday is invented through a thousand ways of bricolage.
—
Axel Fried, 2025
¹ Bohumil Hrabal, Too Loud a Solitude, 1976
² Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind, 1962
³ 35 heures de travail (2002), performance by the artist at Palais de Tokyo
⁴ Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, 1990 (1st ed. 1980)
⁵ Steward Brand, The Whole Earth Catalog, 1968
Manière de faire –Texte pour l’exposition Work In Progress
« Dans l’espace technocratiquement bâti, écrit et fonctionnalisé où ils circulent, les trajectoires des consommateurs forment des phrases imprévisibles, des « traverses » en partie illisibles (…), tracent les ruses d’intérêts autres et des désirs qui ne sont ni déterminés, ni captés par les systèmes où ils se développent. »
Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, 1990
En ancien français, l’expression bayer aux corneilles désignait la propension de quelqu’un à s’extasier face à des objets sans intérêt. Les « corneilles » d’antan qualifiaient alors les choses du quotidien plutôt que nos actuels oiseaux. Comme Hanta, l’ouvrier sur presse de Bohumil Hrabal qui rêvait la nuit d’ériger en piles infinies les livres que son travail à l’usine l’obligeait à détruire le jour¹, les sculptures de Benjamin Sabatier relèvent de la divagation d’atelier, de la petite révolte du maître d’ouvrage et de ce besoin très humain qui consiste à essayer de faire tenir en équilibre tout ce qui se trouve à la portée de sa main lorsque les aiguilles des horloges mettent trop de temps à tourner. Pas de plan, pas de stratégie, pas de chefferie de projet, simplement une intuition, un « et si », suggéré au hasard d’un étai, d’une chute de bois, d’un rebut d’œuvre, d’une canette de bière forte et d’un sac de ciment gardé là selon le principe diogénique du « sait-on jamais, ça peut toujours servir ».
Amoncelée sur une estrade, Work in Progress présente un ensemble de 25 sculptures réalisées par Benjamin Sabatier entre 2004 et 2024. Vingt ans de travaux – et le terme revêt ici une signification particulière – qui gagnent à être regardés à partir de la distinction établie par Claude Lévi-Strauss entre l’ingénieur et le bricoleur². Là où l’ingénieur appréhende le monde de manière théorique et abstraite et dispose d’un choix virtuellement illimité de ressources toujours absentes de son office, le bricoleur travaille dans l’atelier, dans la proximité immédiate et permanente d’un stock limité de matériaux, d’outils et d’objets préexistants, qui ne sont pas forcément les mieux adaptés à la réalisation de l’ouvrage, mais avec lesquels il a ses habitudes. Des heures passées à rêvasser dans la compagnie silencieuse des choses, à écouter ce que suggèrent leurs mécaniques internes et la somme de leurs associations émergent une poïétique, un dialogue permanent où Benjamin Sabatier négocie avec les matériaux l’idée qu’ensemble ils se font d’une forme. Ce dont il est question, c’est de l’être physique de la matière et de la multitude de ses devenirs possibles. Tordu, plié, poncé, raboté, froissé ; réagencé au hasard des principes que leurs usages inspirent, le bois, le béton, le ciment, l’acier et la somme disqualifiée du champ classique de l’art des matériaux de chantier affirment ici leurs qualités, leurs lois, leurs indocilités, leur entêtement, leur obstination à être-là et à ne pas se dérober derrière l’illusion finale de l’œuvre close et achevée. La relation qui lie Benjamin Sabatier au béton, à la brique et au serre-joint tient de la camaraderie et c’est par mutinerie à l’égard de ce que l’art attend traditionnellement d’une forme qu’adviennent ces sculptures espiègles, désinvoltes et franches qu’il expose ici.
Chercher les points de tension, de rupture ou d’équilibre, voir jusqu’où l’on peut pousser avant que l’armature ne cède : si ces expérimentations sont au cœur de la démarche sculpturale de Benjamin Sabatier, la réalité est qu’elles sous-tendent aussi l’ensemble de son œuvre. Qu’il taille des crayons pendant 35 heures, 7 heures par jour et 5 jours par semaine sans jamais dessiner³, qu’il empile des rouleaux de scotch aux airs de monuments à la Troisième Internationale ou qu’il délègue l’effort du montage de ses œuvres à ses collectionneurs – livret de montage, croquis et instructions inclus –, Benjamin Sabatier a passé la quasi-totalité de sa carrière à ne pas faire, à ne pas passer à l’acte, ou plutôt, à faire le moins possible tout en remplissant le cahier des charges que l’entreprise de l’art exige de ses travailleur.
En ce sens, le véritable tour de force qu’il réalise ne tient pas à sa défiance permanente des lois de la physique mais à avoir réussi à faire du bricolage le principe à partir duquel il est à la fois artiste et au monde. Le bricolage est une attitude et cette attitude devient ces formes qui fonctionnent mais qui donnent toujours l’impression de ne jamais avoir été pleinement réalisées – les matériaux regardant, consternés ou amusés, celui qui devait les artifier « bayer aux corneilles » et fantasmer la possible rencontre du béton armé et d’une cale de bois – et les formes cette attitude à partir de laquelle on découvre que le quotidien se bricole et que c’est dans l’environnement immédiat que réside la matière de chaque réalisation en puissance.
Quand le bricolage accommode le réel pour le rendre habitable, il devient braconnage. Cette thèse est développée par le sociologue Michel de Certeau qui, dans les années 70, récusait la thèse selon laquelle les individus ne seraient que des êtres passifs, normés et dépossédés, libres seulement des libertés prévues et permises par leurs milieux. À cette supposée inactivité, de Certeau opposait la fonction créative du braconnage, laquelle ne résiderait pas dans l’érection d’une grande œuvre, mais dans un ensemble de réappropriations, de petites ruses et de pratiques quotidiennes qu’il nommait« manières de faire ». Et ce n’est pas autre chose qu’accomplit Benjamin Sabatier quand il prend un sac de ciment pour du marbre ou un étai pour un burin. Sur des terres qu’il habite mais qui ne lui appartiennent pas, l’artiste se fraie un chemin entre les mailles d’un système, collectionne ce qui lui est utile et se façonne, d’un même geste, une œuvre et une éthique. Assembler, faire, défaire ; baratiner, poncer, tordre, resserrer : à la tétanie amniotique dans laquelle le présent s’engonce, Benjamin Sabatier oppose des verbes actifs ; une somme de sculptures à pratiquer, relire, recopier comme autant d’astuces, de tutoriels et de bons plans partagés de pair à pair. À l’image du Whole Earth Catalogue⁵ – petit guide pratique du do-it-yourself qu’il affectionne tant – Work in Progress peut être consulté comme un manuel pratique dont le premier chapitre dit que le quotidien s’invente par mille manières de bricoler.
—
Axel Fried, 2025
¹ Bohumil Hrabal, Une trop bruyante solitude, 1976
² Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, 1962
³ 35 heures de travail (2002), performance réalisée par l’artiste au Palais de Tokyo
⁴ Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, 1 : Arts de faire, 1990 (1re éd. 1980)
⁵ Steward Brand, The Whole Earth Catalog, 1968