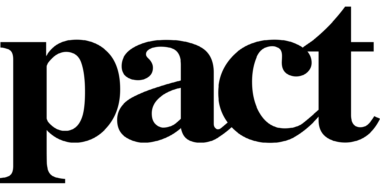Emily Ludwig Shaffer
Stone Tapestry
May 26 - July 19, 2018
Sarah and I met at a launch party for an issue of the publication Riot of Perfume. At the time, I was taking a course taught by the anthropologist Michael Taussig titled ‘Taboo and Transgression’. Taussig had just asked me to help him plan a lecture for the class specific to transgression of taboos in art. We decided to focus on the transgression of form as seen through the work of Duchamp, versus the transgression of taste , as seen through the paintings of Guston. By chance, Sarah was simultaneously working on a piece about Guston’s 1970s political drawings of Richard Nixon. Because of this — and the fact that it was post-election 2016 — we found ourselves in a winding conversation about art and politics. Since then, we’ve been in each other’s company numerous times and on each occasion we find ourselves in long talks about everything from art, news, politics, and astrology, to clothes. It’s one of those new friendships that has formed in part due to, or rather in spite of, the divisive language of the day. As a ‘pact’ I invited Sarah to come to my studio to see the new works, to have one of our invariably rambling conversations, and to have her write what she wished in response.
A Mind/Room of Their/One’s Own
After a studio visit with Emily Ludwig Shaffer
Sarah Cowan
At some point or another you have walked into a room full of a sense of purpose only to stand dumbly, trying to recall what brought you there. The phenomenon has been studied by neuroscientists, and my sister, who is one, told me that it’s known as the “Doorway Effect.” Even experts don’t fully understand why or how it occurs, so I won’t try to explain the science of it, but it has something to do with how much working memory the brain can sustain in a circumstance of competing information. Whatever task you have in mind when exiting one room gets undermined by the more pressing need to make sense of the new room, to immediately draw a cognitive map of the space.
It’s been a century since the idea of a painting as an illusionistic doorway was razed by painters who made declarations of artifice by way of flatness. And yet Emily Ludwig Shaffer is currently making paintings with all the trappings of depth: perspective signals distance, light sources send shadows from familiar objects, plants, and architecture. Her scenes compel you to the edge of the threshold with their glowing aura and colors that appear natural, but somehow enriched. As serene as they are, the worlds Emily frames are not ethereal, like in quadrature paintings. When I visited her studio, she told me that what she paints is “uncomfortably close to observation,” but soon after the first moment of looking, the spaces and their constituents reveal themselves to be “clearly imagined.” She paints with an awareness of contemporary skepticism towards awe, and just as she entices your eyes to believe, she welcomes the critical thinking that comes with doubt. At their edges, her paintings come to an instinctive halt; the halo of blank canvas winks at us, articulating contrivance.
Historically, domestication of space has been the domain of women. “A woman’s touch” is necessary to make a house a home, and most of those (under)paid to do housework are women. Either way, the effort of the labor is supposed to be invisible. To make a painting isn’t so different a task, even if for the longest time it’s been the domain of men. Most of the early defectors from illusionism (think Bonnard, Matisse) still relied on the specificity of pattern and color to draw the viewer into a welcoming, comfortable material reality, with textiles and armchairs, fruit and pastries, particular to time and place. But across all of Emily’s paintings, every object, whether leaf, building, furniture, water, air, or ground, seems to be made out of the same material, something smooth, matte, and precise in its refusal to be identified. The spaces themselves are familiar in their subtraction of distinctiveness, much the way that bank lobbies and doctor’s offices are: generic, newish, suburban.
As I look around Emily’s canvases, my attraction—to the stage-lighting, the jewel tones, the quietude, the tranquility of the paint—is contradicted by a feeling of wariness. It’s mysterious, the way the fern-like plants in My Tapestry II bulge, as if filled with an unseen liquid. It’s unsettling, the way their leaves intersect, like fingers, expressing sentient tenderness, or worse, the mindless ambition of an invasive species, growing wherever it finds an opportunity. The pots in Waiting don’t appear large enough to sustain the life climbing out of them, and the way the vines grow in a standard grid pattern is almost as bizarre as the exactitude with which their purple skin matches the walls to which they attach. They are clearly imagined and imagined clearly, clarified surfaces giving little indication as to the mechanisms behind their behavior. There is an insurmountable distance between my rationale and theirs; everything Emily paints seems to have a mind of its own.
Looking at these paintings and feeling this way, it is as if I have crossed a threshold and the “Doorway Effect” isn’t working right, because I’m lost in un-chartable territory. The perspective in Four posts, three lilies, a cloud alone is so askew that I couldn’t even make my way under the canopy or around the lily pond if I tried. In a space that refuses to be mapped, I can’t begin to recall whatever purpose I had to forget in order to try to make a map. The fact that Emily has made two earlier paintings that depict, leaf-for-leaf, the top left corner of My Tapestry II , seems to imply that the space is endless and complex, that she has observed it and chosen to depict her favorite view, but it’s impossible to verify if her representation is correct.
In her studio, Emily and I talked about Silvia Federici, a leader of the Wages for Housework campaign in Italy, and she told me about Federici’s research on the word “gossip.” It originated as a nickname for female friendship. So often treated as unverifiable sources, women have historically been forced to value context and opinion over evidence to gather information, and sometimes to survive. To share stories of experience is to gather power, and that’s why the word has been undermined over the years.
Emily is a woman painter who creates spaces that are unverifiable; if you find them uninviting, the anxiety that she has captured may be the very alienation that women experience when they have their own minds and are found off-putting, when they reveal themselves to be complex beyond correct answers, when they don’t put you at ease or make it look easy.
Virginia Woolf began her 1929 essay A Room of One’s Own , a lecture on women and fiction, with a disclaimer regarding the advertisement of truth and the consolation prize of a clarified point of view. It may be advisable to read before viewing Emily’s paintings:
I should never be able to fulfill what is, I understand, the first duty of a lecturer to hand you after an hour’s discourse a nugget of pure truth to wrap up between the pages of your notebooks and keep on the mantelpiece for ever. All I could do was to offer you an opinion upon one minor point—a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction; and that, as you will see, leaves the great problem of the true nature of woman and the true nature of fiction unsolved. I have shirked the duty of coming to a conclusion upon these two questions—women and fiction remain, so far as I am concerned, unsolved problems…When a subject is highly controversial—and any question about sex is that—one cannot hope to tell the truth. One can only show how one came to hold whatever opinion one does hold. One can only give one’s audience the chance of drawing their own conclusions as they observe the limitations, the prejudices, the idiosyncrasies of the speaker.
Sarah et moi nous sommes rencontrées à la soirée de lancement d’un numéro du magazine Riot of Perfume. À l’époque, je suivais un cours donné par l’anthropologue Michael Taussig, intitulé « Tabou et transgression ». Taussig venait de me demander de l’aider à préparer pour la classe une conférence dédiée à la transgression des tabous dans l’art. Nous avions décidé de nous concentrer sur la transgression de la forme, telle qu’elle apparaît dans l’œuvre de Duchamp, par opposition à la transgression du goût, telle qu’elle apparaît dans les tableaux de Philip Guston. Par le fait du hasard, Sarah travaillait parallèlement à un article sur les dessins politiques de Richard Nixon par Guston dans les années 1970. Pour cette raison – et parce que c’était après l’élection de 2016 – nous nous sommes retrouvées à échanger de longues digressions sur l’art et la politique. Depuis, nous nous sommes croisées à de nombreuses reprises, et à chaque fois nous nous retrouvons dans de longues discussions sur toutes sortes de sujets, de l’art, des actualités, de la politique et de l’astrologie à l’habillement. C’est l’une de ces nouvelles amitiés qui sont nées, pour une part, en raison ou plutôt en dépit de la rhétorique clivante du moment. En vue du présent « pacte », j’ai invité Sarah à se rendre dans mon atelier pour voir mes derniers travaux, pour engager l’une de nos conversations invariablement décousues, et pour qu’elle écrive ce qui lui plairait en réponse.
A Mind/Room of Their/One’s Own1 // Un esprit/lieu à elles/à soi
Après une visite d’atelier avec Emily Ludwig Shaffer
Sarah Cowan
Vous êtes déjà entré dans une pièce, animé d’une intention précise, pour vous retrouver planté sur le pas de la porte, incapable de vous rappeler ce qui vous amenait là. Ce phénomène a été étudié par les neuroscientifiques, et ma sœur, qui en est une, m’a appris qu’il était connu sous le nom de « doorway effect ». Même les experts ne s’expliquent pas complètement pourquoi et comment cela se produit, je n’essaierai donc pas d’en donner l’explication scientifique, mais elle a trait à la quantité de mémoire de travail que le cerveau peut maintenir dans une situation où plusieurs informations se font concurrence. La nécessité immédiate de se repérer dans un lieu nouveau, d’établir sur-le-champ une carte cognitive de l’espace, prend le dessus sur la tâche qu’on avait en tête au moment de quitter la pièce précédente.
Il y a un siècle que l’idée du tableau comme porte illusionniste a été balayée par les peintres qui ont revendiqué l’artifice à travers la planéité. Et pourtant, aujourd’hui, Emily Ludwig Shaffer réalise des tableaux qui présentent tous les attributs de la profondeur : la perspective signale la distance, l’éclairage allonge les ombres d’objets familiers, de plantes, du décor architectural. Ses scènes vous poussent au bord du seuil, avec leur aura lumineuse, et leurs couleurs, qui semblent naturelles, mais comme exaltées. Tout sereins qu’ils soient, les mondes immortalisés par Emily ne sont pas éthérés, comme dans les peintures en quadratura. Lors de ma visite de son atelier, elle m’a dit que ce qu’elle peignait était « inconfortablement proche de l’observation », mais les premiers instants d’attention passés, les espaces et leurs éléments constitutifs se révèlent être « clairement imaginés ». Elle peint avec l’intuition du scepticisme que notre époque réserve à l’émerveillement, et tandis qu’elle vous incite à vous fier à la vue qui s’offre à vous, elle invite la réflexion critique qui accompagne le doute. À la marge, ses peintures s’arrêtent instinctivement ; le halo de toile blanche nous interpelle, témoignant de leur caractère artificiel.
Par le passé, la domestication de l’espace a toujours été le domaine des femmes. Une « touche féminine » est indispensable pour faire d’une maison un foyer accueillant, et la plupart de ceux qu’on (sous-)paye pour réaliser des travaux ménagers sont des femmes. Dans un cas comme dans l’autre, l’effort du travail est censé être invisible. L’exécution d’un tableau n’est pas une tâche si différente, quand bien même elle a longtemps relevé du domaine des hommes. Pour la plupart, les premiers dissidents de l’illusionnisme (pensez à Bonnard, à Matisse) s’appuyaient encore sur la spécificité du motif et de la couleur pour attirer le spectateur dans une réalité matérielle accueillante et confortable, avec des tissus et des fauteuils, des fruits et des pâtisseries, ancrés dans une époque et dans un lieu. Mais dans les peintures d’Emily, chaque élément, qu’il s’agisse d’une feuille, d’un bâtiment, d’un meuble, de l’eau, de l’air ou du sol, semble être fait du même matériau: quelque chose de lisse, de mat, et de rigoureusement réfractaire à l’identification. Les espaces eux-mêmes sont rendus familiers par le fait que tout caractère distinctif leur a été retiré, à l’instar des halls de banque et des cabinets médicaux : quelconques, récents, uniformes.
Alors que je parcours les toiles d’Emily, mon attirance – pour l’éclairage scénique, pour les teintes joyaux, pour la quiétude, la tranquillité de la peinture – est contredite par un sentiment de défiance. Il y a quelque chose de mystérieux à la façon dont les plantes- fougères de My Tapestry II (Ma tapisserie II) se renflent, comme remplies d’un liquide invisible ; quelque chose de troublant à la façon dont leurs feuilles se croisent, comme les doigts d’une main, manifestant une tendresse sentiente, ou pire, l’ambition aveugle d’une espèce invasive qui s’introduit partout où elle en trouve le moyen. Les pots de Waiting (Attente) paraissent trop petits pour assurer la subsistance des plantes grimpantes qui s’en élèvent, et la façon qu’elles ont de pousser en quadrillage régulier est presque aussi étrange que l’exactitude avec laquelle leur peau violette coïncide avec le mur auquel elles se rattachent. Clairement imaginées, et imaginées clairement, ces surfaces clarifiées donnent peu d’indices quant aux mécanismes qui sous-tendent leur comportement. Une distance insurmontable sépare ma logique de la leur ; tout ce qu’Emily peint semble animé d’une volonté propre.
Quand j’observe ces tableaux, dans cet état d’esprit, c’est comme si j’avais franchi un pas de porte et que le « doorway effect » n’opérait pas, car je suis perdue en territoire inexplorable. La perspective dans Four Posts, Three Lilies, A Cloud Alone (Quatre poteaux, trois nénuphars, un nuage seul) est si biaisée que, si j’essayais, je ne pourrais même pas me frayer un chemin sous la tonnelle, ou contourner le bassin aux nénuphars. Dans un espace qui refuse de se laisser cartographier, je n’ai plus la moindre idée de l’intention que je devais oublier pour essayer de faire une carte. Le fait qu’Emily ait réalisé deux peintures antérieures figurant, feuille pour feuille, le coin supérieur gauche de My Tapestry II semble suggérer que l’espace est infini et complexe, qu’elle l’a observé et qu’elle a choisi de représenter son point de vue favori ; mais il est impossible de vérifier l’exactitude de sa représentation.
Dans son atelier, Emily et moi avons discuté de Silvia Federici, figure emblématique du mouvement Wages for Housework (« un salaire au travail ménager ») en Italie, et elle m’a parlé des recherches de Federici sur le mot « gossip » (bavardages, commérages), qui à l’origine désignait une amitié entre femmes. Si souvent traitées en sources invérifiables, les femmes ont toujours été forcées d’attacher plus d’importance au contexte et à l’opinion qu’aux faits pour rassembler des informations, et parfois pour survivre. Échanger des récits d’expérience, c’est rassembler du pouvoir, voilà pourquoi le terme a été déprécié au fil des ans.
Emily est une femme peintre qui crée des espaces invérifiables ; si vous les trouvez peu invitants, il se peut que le sentiment d’anxiété qu’elle a capturé corresponde à l’aliénation même que les femmes encourent quand elles pensent par elles-mêmes et suscitent l’aversion, quand les réponses attendues ne suffisent pas à rendre compte de leur complexité, quand elles ne mettent pas à l’aise ou ne feignent pas la facilité.
En 1929, Virginia Woolf faisait commencer son essai A Room of One’s Own (Un lieu à soi), une conférence sur les femmes et la fiction, par un avertissement concernant les prétentions à la vérité, et la consolation que procure un point de vue éclairé. Avant de voir les tableaux d’Emily, il conviendrait peut-être d’en lire ce passage :
Je ne pourrai jamais remplir ce qui est, semble-t-il, le premier devoir d’une conférencière : vous remettre, au bout d’une heure de dissertation, une pépite de pure vérité à envelopper entre les pages de vos carnets, et à conserver pour toujours sur le manteau de la cheminée. Tout ce que je pouvais faire, c’était vous donner mon avis sur un sujet mineur – une femme doit avoir de l’argent et un lieu à elle si elle veut écrire de la fiction ; et cela, comme vous le verrez, ne résout pas le grand problème de la vraie nature de la femme ni de la vraie nature de la fiction. Je me suis dérobée au devoir d’arriver à une conclusion sur ces deux questions – les femmes et la fiction restent quant à moi des problèmes en suspens. […] quand un sujet est hautement controversé – ce qu’est toute question ayant trait au sexe – on ne peut espérer dire la vérité. On ne peut que montrer comment on en est venu à être de l’avis qu’on soutient. On ne peut que donner à ses auditeurs l’occasion de tirer leurs propres conclusions, tandis qu’ils observent les limites, les préjudices, les traits particuliers de l’oratrice.